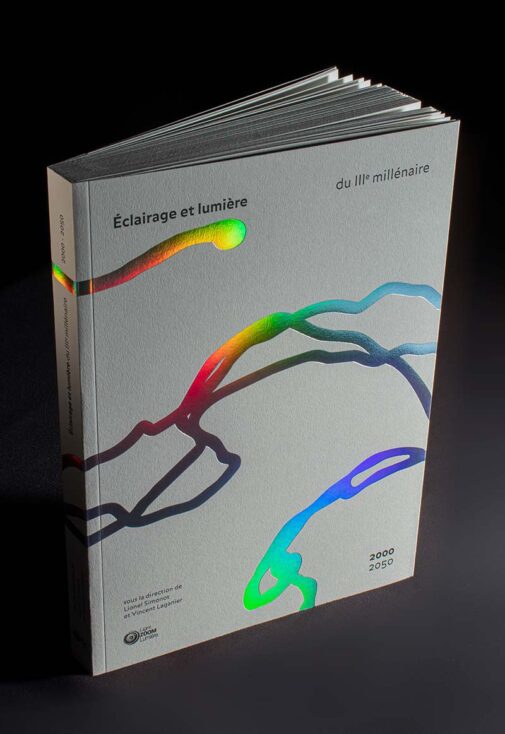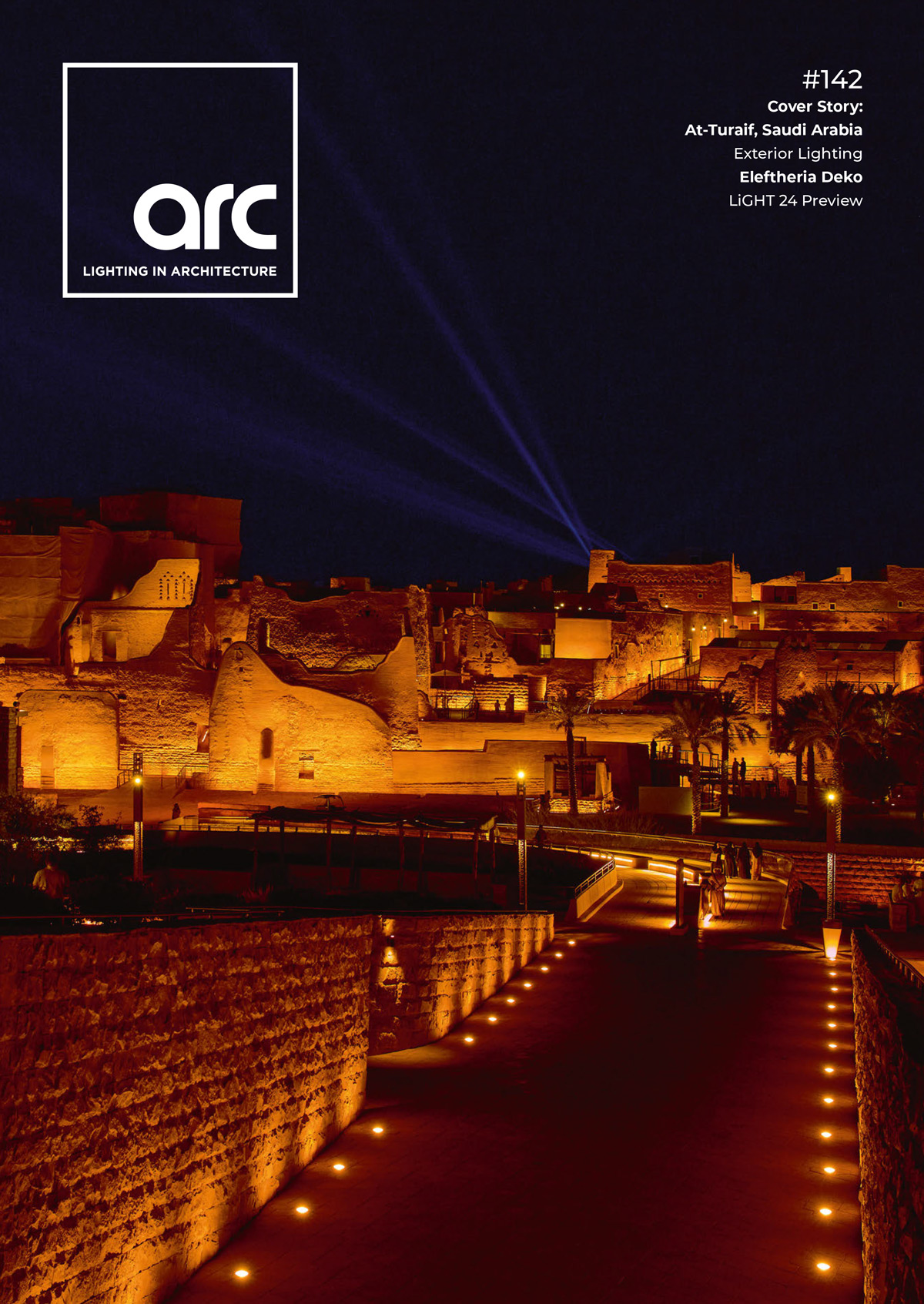Julia Margaret Cameron : l’émouvante sensibilité du collodion

Quelle est la première expérience photographique de Julia Margaret Cameron ? Elle l’affronta en faisant le portrait de la fille d’un voisin. La phase préalable à la prise de vue impliquait alors, de la part du photographe, la préparation manuelle de la plaque de verre. Cette dernière devait être trempée dans une solution photosensible puis insérée dans le boîtier, avant de déclencher enfin une exposition en pose longue. C’est donc à l’issue d’une succession de rituels précautionneux qui constituaient le quotidien des photographes de ce temps que Julia Margaret Cameron aboutit finalement à la constatation de l’image.
« Cameron est peut-être un des premiers photographes, peut-être le premier, à avoir pensé que la photographie n’était pas qu’une représentation de la réalité, mais que c’était une révélation. »
Paolo Roversi, 2019, extrait de l’exposition Julia Margaret Cameron, capturer la beauté.
« J’avais hâte de fixer toute la beauté qui se présentait à moi et mon souhait fut exaucé. »
Julia Margaret Cameron, Virginia Woolf et Roger Fry, Annales de ma maison de verre, Paris, Casimiro livres, 2023, p.30.
Partager ses impressions de l’étonnante exposition dédiée à la photographe anglaise Julia Margaret Cameron (1815-1879), un authentique enseignement que nous raconte Richard Caratti-Zarytkiewicz. À voir absolument au musée du Jeu de Paume à Paris, du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024.
Julia Margaret Cameron, la fusion du corps et de l’âme avec la photographie
Émerveillée, frappée émotionnellement par cette expérience tout aussi esthétique que laborieuse, elle ressentit alors physiquement le déroulement du phénomène de la captation photographique. Un évènement dont l’origine était en fait le modèle : l’enfant lui-même. « Je courais dans toute la maison chercher des cadeaux pour cette enfant, j’avais le sentiment qu’elle seule avait fait cette photographie », nous dit-elle enthousiaste dans le livre de Julia Margaret Cameron, Virginia Woolf et Roger Fry, Annales de ma maison de verre.

Ce fut comme si le charme naturel de cette petite fille avait, comme par magie, généré l’image, et en même temps la mutation en émotion pure de cette photographie si matériellement et laborieusement obtenue. Elle inventait ainsi, dans ce même instant, sa propre conscience du phénomène photographique. Elle replaçait ce dernier dans un contexte artistique et poétique à la hauteur de l’émotion ressentie. Ce fut son enthousiasme qui éclata alors, le même qui durant toute sa vie se renouvela « […] à chaque fois qu’une nouvelle gloire » s’affichera « […] sur une plaque de verre », comme elle l’écrivit dans ce livre.
Le retour à la racine de l’idée d’image
Ce sentiment, de nombreux photographes le reconnaîtront, c’est celui qu’ils (elles) ont ressenti lors de leurs premières expériences ou bien dans les moments les plus intenses de leur parcours. C’est celui d’entrer physiquement en contact avec l’énergie et le déroulement du phénomène lumineux depuis le sujet jusqu’à la pellicule ou au capteur.
Bien que passionnée de science, comme elle le déclara alors que dans la lointaine Calcutta, les découvertes scientifiques lui parvenaient « […] comme de l’eau aux lèvres desséchées d’un assoiffé », elle choisit néanmoins, poussée par cette passion naissante, de réexplorer une sensation qui fut celle des anciens et subsista pendant plusieurs siècles en tant qu’hypothèse interprétative du phénomène visuel. Consciemment ou inconsciemment, elle se rapprochait ainsi d’Épicure, de Démocrite ou de Lucrèce qui, en leur temps, avaient décrit de manière intuitive (et quelque peu fantasmagorique au vu des connaissances acquises à ce jour) le processus de la vision des objets, des êtres, des faits et des paysages comme étant la résultante d’effluves ou de « simulacres ». Selon eux, ces simulacres, émis par le sujet observé et qui représentaient son image sous forme d’effluves, traversaient l’espace. Ils venaient ensuite, selon les versions en vigueur à l’époque, soit se présenter devant l’œil, soit le pénétrer, formant ainsi l’image à l’intérieur de notre esprit.

« C’est pourquoi, je le répète, il faut reconnaître que des émanations des corps frappent nos yeux et provoquent la vue. »
Lucrèce, De rerum natura (De la nature des choses), Existence et nature des simulacres Livre IV, ligne 217.
De la photographie à une indéfinition visuelle
Julia Margaret Cameron avait donc, dans son élan passionnel, fait en quelque sorte le choix d’une fantasmagorie stimulante mue par l’intensité de l’émotion transmise par l’image obtenue. Elle lui semblait acquérir une capacité transmissive supplémentaire, outre celle du phénomène lumineux. Dans ce sentiment intime, elle décelait une participation active du sujet dans le processus de communication de sa propre image à la plaque sensible. Ce retour à cette racine même de l’idée d’image nous apparaît ici comme fondatrice de son élan passionnel pour la photographie et de l’ensemble de sa démarche.
« Il n’y a aucune distinction entre mon œuvre et ma vie et je pense qu’il en était de même pour elle […]. C’est une célébration de l’amour, ce qui pour moi est ce que l’art peut accomplir de plus grand. » Citation de Nan Goldin reprise dans le parcours d’introduction de l’exposition.
J.M. Cameron, l’exploration de la nature du sujet
Au cours de sa carrière, son souci de la perfection se dédia tout entier à sa recherche visuelle. Celle-ci trouva son expression la plus pure dans une indéfinition visuelle que beaucoup lui reprochèrent avec véhémence. Sa nièce, l’écrivaine Virginia Woolf, témoigne de l’intensité de son intention lorsqu’elle nous révèle qu’« elle avait pris l’habitude de dire que dans son œuvre, une centaine de négatifs étaient détruits avant d’obtenir un résultat probant. Son objectif étant de surmonter le réalisme en atténuant la précision de la mise au point », une constance passionnelle qui l’amenait à ne pas se soucier « […] de sa peine, de ses échecs et de son épuisement ».
Le naturalisme selon J. M. Cameron
Comme ce fut le cas pour d’autres photographes de cette époque – qui voyait la construction de l’image photographique faire ses premiers pas –, elle eut recours à l’inspiration des thèmes et des compositions propres à la peinture classique et, dans son cas plus précisément, de celle de la Renaissance italienne. Ce fut pour elle l’occasion de se lancer dans la recherche d’un résultat qui renonçait d’emblée à cette précision descriptive des scènes observées, appelée réalisme. On pourrait en fait définir son approche comme naturaliste, c’est-à-dire similaire à celle recherchée par les peintres du Quattrocento et du Cinquecento.

C’est ce naturalisme qui tire son nom de la recherche de la nature même du sujet au sens large, laquelle est le résultat d’une quête visuelle qui ne se résout en aucun cas par la représentation précise, fidèle et définitive des volumétries, des couleurs, des objets et des corps, mais plutôt par des impressions traduisant la substance qui pouvait s’en dégager. Il s’agit de ce naturalisme qui, dans l’art antique, assumait « […] une signification telle que le naturel devient l’expression d’une vérité profonde », comme le remarquent Giulio Carlo Argan et Rudolf Wittkower en puisant chez Dagoberto Frey d’après la citation du livre Architecture et perspective chez Brunelleschi et Alberti (2004), Paris, éd. Verdier, page 9.
Dans sa correspondance, elle citera ce conseil qui lui fut prodigué par le peintre Georges Watts, son « conseiller artistique », de faire « des photos non pas tirées de la vie, mais tournées vers la vie », décrit Joanne Lukitsch dans Julia Margaret Cameron (2001).

La recherche de Julia Margaret Cameron
La quête de cette nature fut depuis des temps très anciens la marque des artistes universels, celle d’un Praxitèle, d’un Michel-Ange ou d’un Caravaggio. Elle était alors révélatrice des mystères de l’harmonie universelle à travers l’exploration de notre vision et de sa représentation dans la mesure où, selon les philosophes et les théologiens, nous, microcosmes, de même que la nature qui nous entoure, étions faits à l’image du macrocosme, de l’universel. Elle rapprochait donc du divin, ou en d’autres termes de l’universel, et nous mettait en contact tant avec les forces cosmiques qu’avec la part cachée de notre nature. Elle fut également, et de manière plus incisive, l’objectif d’un Klimt, d’un Egon Schiele, ou d’un Oskar Kokoschka, plongés dans la réflexion psychanalytique qui baignait le monde intellectuel viennois des années 1900. C’était alors l’exploration de la nature humaine qui devait construire l’image et la perception visuelle, comme le dit clairement Eric R. Kandel dans The Age of Insight, ouvrage essentiel de ce début du XXIe siècle dont la traduction française se fait cruellement attendre depuis sa parution en 2012 : « Entre les mains de Klimt et de ses protégés, Oskar Kokoschka et Egon Schiele, la peinture s’efforçait de se démontrer similaire à l’écriture créative ainsi qu’à la psychanalyse dans sa capacité d’investigation au cœur des pratiques restrictives de la société viennoise […] et de révéler le véritable état intérieur des individus », écrit Eric R. Kandel (2012) dans The Age of Insight, the Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain.
Les impressionnistes étaient déjà passés par là en divisant l’image en petites touches, et ce fut ensuite le tour du cubisme, décomposant puis recomposant l’objet. Plus près de nous, Mark Rothko ou James Turrell choisirent de placer notre perception devant un questionnement sans cesse reformulé, intériorisé à l’extrême, et révélateur chez l’observateur des besoins et des capacités insoupçonnés et indicibles de notre esprit, dans l’ouvrage de Eric R. Kandel (2016), Reductionism in Art and Brain Science, Bridging the Two Cultures.

En ce sens, cette recherche naturaliste de Julia Maria Cameron peut sans doute être vue comme emblématique de l’identité de l’artiste en tant qu’investigatrice du vocabulaire artistique chercheuse à travers les âges, depuis le monde gréco-romain jusqu’à nos jours. Son œuvre constitue en réalité un trait d’union entre ce que nous appellerons « le monde d’avant 1880 », dans lequel on ne rencontrait l’image qu’exceptionnellement, et « le monde d’après 1880 » depuis le jour où, tout d’abord par la diffusion massive de la carte postale, et donc successivement de l’image photographique, puis cinématographique, et aujourd’hui vidéographique et digitale, l’image a envahi notre univers, notre imaginaire, notre mode de pensée, et pris possession de notre conscience du monde, remplaçant l’écrit.
Conclusion
La démarche artistique de J.M. Cameron, en s’adressant sans ambages à notre émotion et par son renoncement à l’exigence de la netteté, nous permet d’accéder aux contours de notre imaginaire. Dans une dimension poétique qui constitue un parcours de découverte à suivre pas à pas, elle dévoile une vérité dissimulée et qui ne sera révélée que par la disponibilité de l’observateur à effleurer – voire à explorer sous l’effet de la vibration de la lumière – les recoins de son esprit, le sien propre, en même temps que celui de l’artiste.

Nous vous laisserons finalement la liberté de découvrir au fil de votre visite les trois ou quatre tirages qui, extraits de l’obscurité profonde comme en une sélection de touches de lumière choisies au fil de la forme des visages, nous apparaît par exemple la physionomie de Mrs Julia Jackson ou d’autres, qui à l’instar du Baiser de Paix présenté dans ces colonnes, s’en libèrent à peine, mais juste assez pour que nous soyons tentés d’y être nous aussi partiellement engloutis en leur compagnie.

Approfondir le sujet
- Robert Doisneau, portraits d’artistes et vues de Lyon
- Georges Fessy : secrets lumineux de la nature morte au portrait
- Lampes design à poser, sur le retour de Maison & Objet
- L’art de l’éclairage, de Jean Turco – Photo portrait, nu et nature morte

Photo en tête de l’article : Julia Margaret Cameron – St. Agnes 1864 – Tirage albuminé © The Royal Photographic Society Collection at the V&A, acquired with the generous assistance of the National Lottery Heritage Fund and Art Fund
Lieu
- Jeu de Paume
- Paris, France